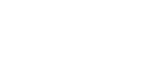Les travaux scientifiques menés par les lauréats des bourses de recherche de la Fondation apporteront cette année un éclairage particulier sur trois sujets :
- La « localisation » et les obstacles et perspectives de l’action humanitaire locale
- Le bénévolat en pleine mutation
- Les conséquences sanitaires des changements climatiques
En réponse à ces enjeux contemporains, les chercheurs présenteront des clés de compréhension mais aussi des pistes de recommandation pour repenser l’action et améliorer le sort des personnes accompagnées.
La journée se clôturera par la cérémonie de remise des prix de recherche 2025 de la Fondation.
Un replay sera disponible
9h00 – 9h30 : Accueil des participants
9h30 – 9h40 : Mots de bienvenue
- Stéphanie Tchiombiano, maîtresse de conférence associée, co-responsable du Master Développement et Action Humanitaire (DAH) de l’École de science politique de La Sorbonne
- Caroline Cross, présidente de la Croix-Rouge française et de la Fondation Croix-Rouge française
9h40 – 10h00 : Propos introductifs : « Bouleversement du secteur humanitaire : quel avenir pour la solidarité internationale ? »
- Virginie Troit, directrice générale de la Fondation Croix-Rouge française
- Stéphanie Tchiombiano, maîtresse de conférence associée, co-responsable du Master DAH de l’École de science politique de La Sorbonne
- Anicet Zran, historien de la santé, enseignant-chercheur à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
- Philippe Ryfman, professeur et chercheur associé honoraire au département de science politique au Centre Européen de Sociologie et Science Politique de La Sorbonne (CESSP-Sorbonne)
10h00 – 11h30
THÈME 1 : OBSTACLES ET PERSPECTIVES DE L’ACTION HUMANITAIRE LOCALE
Dix ans après le Sommet mondial humanitaire, comment concilier les dimensions locale et globale de l’aide humanitaire ?
Présentation des résultats des recherches soutenues par la Fondation
Modération : Vincent Leger, chargé de recherche, Fondation Croix-Rouge française
Intervenants :
- Jean-Emile Mba, politiste, chercheur associé au Centre d’Études et de Recherche en Paix, Sécurité et Intégration (CERPSI) de l’Université de Maroua (Cameroun) et à l’Observatoire Canadien sur les Crises et l’Action Humanitaires (OCCAH, Canada), expert sur les questions éthiques au sein de l’agence des Nations Unies pour les migrations (ONU-Migration).
Pour sa recherche : « Autonomisation des organisations à base communautaire au Cameroun : expérimentation, défis opérationnels et pistes de réformes pour une transition humanitaire par le bas »
- Léopold Ngueuta Nouffeussie, politiste, enseignant-chercheur au Département de Science Politique de l’Université de Maroua (Cameroun)
Pour sa recherche : » Réseaux des ONG nationales et locales au Cameroun et dans le Bassin du Lac-Tchad : entre obstructions étatiques et dissensions internes «
Table ronde
Depuis le Sommet humanitaire mondial de 2016, la notion de « localisation » de l’aide occupe une place de plus en plus importante dans le débat autour de l’aide internationale, résumant presque à elle seule la nécessité de la réformer et la réponse possible aux nombreux problèmes auxquels elle se heurte aujourd’hui.
Ce mouvement de « localisation de l’aide » est généralement défini comme un processus inclusif des différentes parties prenantes du système humanitaire (États, bailleurs de fonds, organismes des Nations Unies, ONG et organisations locales) qui vise à ramener les acteurs locaux (autorités locales et société civile) au centre du système humanitaire. En plus de permettre une réponse humanitaire plus efficace et ancrée sur l’émancipation des pouvoirs locaux, l’objectif à long terme de la localisation est de renforcer la résilience des communautés touchées par la crise en établissant des liens avec les activités de développement.
Cette dynamique semblait témoigner d’une évolution importante des relations Nord/Sud, en appelant à des réponses « aussi locales que possible, aussi internationales que nécessaire » et à un engagement des donateurs et organisations d’aide à investir davantage dans la capacité des organisations locales à travailler en complément avec leurs homologues internationaux. Mais, presque 10 ans après, force est de constater que cet engagement peine à se réaliser dans les faits, malgré de nombreuses promesses, dont celle qui engageait les donateurs et organisations d’aide à fournir 25% du financement humanitaire mondial aux intervenants locaux et nationaux d’ici 2020 (1,2 % en 2021).
Il y a peu de consensus sur ce que signifie une réponse véritablement « locale » en théorie – d’ailleurs la traduction du mot anglais « localisation » dans d’autres langues, comme le français, ajoute parfois de la confusion –, et en pratique on observe que cela peut prendre des formes très différentes et qu’il y a très peu d’incitations à la promouvoir au sein d’un système enclin à la centralisation structurelle et culturelle. En conséquence, les initiatives allant dans ce sens, même si elles montent en puissance, demeurent marginales et les premières leçons tirées du débat sur la « localisation », ou encore la « fragmentation » de l’aide, montrent la vivacité de la discussion sur la façon dont l’articulation des deux dimensions « globales » et « locales » du système de solidarité internationale se traduit sur le terrain en termes d’efficacité, de coordination des aides extérieures avec les dispositifs d’aide intérieurs, et d’adéquation de l’aide avec les besoins des populations.
Cette table ronde discutera des obstacles et perspectives de l’action humanitaire locale. Qu’en est-il de l’action humanitaire locale, et de la « localisation » de l’aide humanitaire, presque dix ans après le Somment mondial humanitaire ? Comment concilier les dimensions locale et globale de l’aide humanitaire, notamment dans les contextes d’humanitaire durable ? Quels modèles émergents permettent d’envisager de nouvelles voies sur le rôle et le développement des acteurs locaux, nationaux et régionaux dans les régions du monde bénéficiaires de l’aide internationale ?
Modération :
- Monique Beerli, maîtresse d’enseignement et de recherche en études globales au Global Studies Institute de l’Université de Genève
- Virginie Troit, directrice générale de la Fondation Croix-Rouge française
Intervenants :
- Jean-Emile Mba, politiste, chercheur associé au Centre d’études et de recherche en paix, sécurité et intégration (CERPSI) de l’Université de Maroua (Cameroun) et à l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires (OCCAH, Canada), expert sur les questions éthiques au sein de l’agence des Nations Unies pour les migrations (ONU-Migration).
- Henri Leblanc, directeur général adjoint de l’ONG ALIMA (The Alliance for International Medical Action)
- Annette Msabeni, responsable de la transformation organisationnelle à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
- Léopold Ngueuta Nouffeussie, politiste, enseignant-chercheur au Département de Science Politique de l’Université de Maroua (Cameroun)
11h30 – 11h40 : Pause
11h40 – 13h10
THÈME 2 : LE BÉNÉVOLAT EN PLEINE MUTATION
Que racontent les nouvelles formes d’engagement du devenir de l’action humanitaire et sociale ?
Présentations des résultats des recherches soutenues par la Fondation
Modération : Vincent Leger, chargé de recherche, Fondation Croix-Rouge française
Intervenants :
- Leila Drif, anthropologue, post-doctorante à la Maison des sciences de l’Homme de Pacifique
Pour sa recherche : « Des réfugies pairs aidants : le bénévolat par et pour les régugiés, un modèle alternatif d’insertion ? »
- Jordan Pinel, géographe, enseignant-chercheur à Cergy Paris Université
Pour sa recherche : « Engagements citoyens pour les Ukrainiens : une réponse hors des grandes villes »
Table ronde
Le bénévolat est l’un des principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge, et ses millions de volontaires constituent sa clé de voûte et représentent sa plus grande source d’inspiration et d’innovation. En France, c’est grâce à ses 70 000 bénévoles que la Croix-Rouge française intervient chaque jour dans des domaines variés : action sociale, urgence et opérations de secours, prévention des risques, soutien psychologique… Qu’ils soient formateurs aux gestes qui sauvent, maraudeurs à la rencontre des personnes sans-abri, secouristes, animateurs jeunesse ou quêteurs d’un jour, tous contribuent, chacun à leur façon et conformément à l’objectif du Mouvement, « à prévenir et alléger les souffrances humaines », selon son principe d’Humanité.
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tout comme de nombreuses autres organisations à travers le monde, doit néanmoins répondre à un certain nombre d’interrogations sur ses pratiques bénévoles. Les récents évènements tels que la pandémie de COVID-19 ou la guerre en Ukraine en ont nettement montré les limites et ont redonné une place centrale à certaines questions liées à l’engagement, qu’il s’agisse de la protection de la santé physique et mentale des bénévoles en période de conflits et d’urgences ou de l’encadrement des nouvelles formes de bénévolat, notamment des volontaires « spontanés ».
Plus largement, ces événements ont précipité un processus de mutation enclenché depuis quelques années, qui voit apparaître de nouvelles formes d’entraide et de solidarité, une population bénévole jeune à la recherche de missions souvent plus courtes et variées, ainsi qu’un militantisme associatif ou via des collectifs de citoyens ou des groupes informels. Tout cela, couplé à une grande banalisation de l’acte bénévole due à la multiplication du nombre des associations et celle des citoyens actifs, dessine une image floue du bénévolat, un trouble dans la compréhension de son évolution et sa définition même. Que racontent les nouvelles formes d’engagement du devenir de l’action humanitaire et sociale ? Quelles nouvelles formes de bénévolat sont pertinentes pour le XXI e siècle ? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions que cette table ronde abordera.
Modération :
- Dan Ferrand-Bechmann, sociologue, professeur émérite à l’Université 8 Vincennes – Saint-Denis
- Vincent Leger, chargé de recherche, Fondation Croix-Rouge française
Intervenants :
- Hubert Pénicaud, responsable participation et démocratie interne à la Croix-Rouge française
- Leila Drif, Anthropologue, post-doctorante à la Maison des sciences de l’Homme de Pacifique
- Jordan Pinel, Géographe, enseignant-chercheur à Cergy Paris Université
13h10 – 14h30 : Déjeuner libre à l’extérieur
14h30 – 16h00
THÈME 3 : LES CONSÉQUENCES SANITAIRES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Comment adapter les modes de réponse humanitaire et les systèmes de santé à ces bouleversements ?
Présentation des résultats des recherches soutenues par la Fondation
Modération : Vincent Leger, chargé de recherche, Fondation Croix-Rouge française
Intervenants :
- Jean-Marc Goudet, sociologue et médecin, post-doctorant à l’Inserm
Pour sa recherche : «Température extrême et santé mentale des mères et enfants au nord du Sénégal »
- Modou Ndiaye, géographe, chercheur à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN-Cheikh Anta) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
Pour sa recherche : « Perception du risque sanitaire et adaptation au changement climatique des populations de la Langue de Barbarie (Saint-Louis du Sénégal) »
Table ronde
Les projections les plus récentes indiquent que l’augmentation de la température moyenne de 1,5 °C sera atteinte dès le début des années 2030, indépendamment des efforts de réduction des émissions mondiales de CO2. Le changement climatique n’est donc plus une menace lointaine, mais bien une réalité quotidienne. Et les dégâts qu’il engendre sur la biodiversité, les moyens de subsistance ou encore la santé humaine vont croissant.
Les volontaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont témoins de l’impact des crises climatiques sur la population. A la Croix-Rouge française par exemple, le temps moyen de mobilisation pour une opération d’urgence a doublé en l’espace de 10 ans. Ses équipes interviennent plus souvent et plus longtemps pour faire face à des catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes et intenses.
Ces événements climatiques extrêmes ne deviennent des catastrophes que si la population est insuffisamment préparée. Or l’exposition des populations et sociétés aux risques climatiques augmente plus vite que leur niveau de préparation à leurs impacts directs et indirects sur la santé humaine, ainsi que sur les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé. Ceux-ci affectant aussi bien directement les populations (décès, blessures, maladies, etc.) que l’organisation des sociétés (récoltes, accès à l’eau, l’électricité, etc.) et les systèmes de santé (accès des secours, approvisionnement de matériels médicaux, disponibilité de personnel qualifié, etc.), la préparation doit être individuelle et collective.
Ainsi, il semble plus important que jamais de renforcer le plaidoyer en faveur d’une réinvention des modes de réponse humanitaire et de l’adaptation des systèmes de santé aux bouleversements en cours. Aussi, devant l’intensification des crises humanitaires liées au changement climatique, certains voient une opportunité pour réformer le secteur humanitaire et en proposent une refonte autour d’un « nouvel humanisme » qui intègre l’humain et les écosystèmes. Comment adapter les modes de réponse humanitaire et les systèmes de santé aux conséquences sanitaires du changement climatique ? Et, dans ce contexte en forte évolution, comment répondre aux besoins immédiats tout en anticipant les impacts de long terme sur les populations et les écosystèmes ? Ce sont quelques-unes des nombreuses questions que cette table ronde abordera.
Modération :
- Louise Baumann, chargée de recherche, Fondation Croix-Rouge française
- Sylvie Ollitrault, directrice de recherche au CNRS, ISP Nanterre et directrice de la recherche à l’Ecole des Hautes Études en Santé Publique (EHESP-Rennes)
Intervenants :
- Jean-Marc Goudet, sociologue et médecin, post-doctorant à l’Inserm
- Modou Ndiaye, géographe, chercheur à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN-Cheikh Anta) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
- Chloé Orland, docteure en écologie de l’Université de Cambridge, référence écologie chez Action Contre la Faim France
- Philippe Testa, adjoint au directeur de l’Urgence et des Opérations (DUO) de la Croix-Rouge française
16h00 – 16h30
Intervention des étudiants du Master DAH de l’École de science politique de La Sorbonne
Modération : Stéphanie Tchiombiano, maîtresse de conférences associée, co-responsable du Master DAH de l’École de science politique de La Sorbonne
Le Master DAH ( Développement et Action Humanitaire) de l’École de Science politique de la Sorbonne offre une formation intellectuelle approfondie, permettant aux étudiants d’acquérir des outils analytiques pour mieux comprendre les dynamiques de l’aide au développement et de l’action humanitaire. Cette formation repose sur l’étude des systèmes institutionnels, des mécanismes d’intervention, des principes et normes qui orientent l’action dans ces domaines, ainsi que sur l’analyse des enjeux politiques et économiques qui les traversent. Au cours de cette session, des étudiants en Master DAH reviendront sur les enseignements tirés des différentes tables rondes et leurs enjeux pour l’action humanitaire.
16h30 – 16h40 : Pause
16h40 – 17h40
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DE RECHERCHE 2025
Mots d’introduction : Laurent Vidal, président du conseil scientifique de la Fondation Croix-Rouge française
Remise des prix aux trois lauréats 2025
17h40 – 18h00 : Mots de clôture de la journée
- Françoise Fromageau, vice-présidente de la Fondation Croix-Rouge française
- Virginie Troit, directrice générale de la Fondation Croix-Rouge française
En savoir plus…
Informations pratiques
Revivre l’édition 2023
(édition spéciale 10 ans de la Fondation)
En partenariat avec

Partenaires recherche



Partenaires des prix 2025