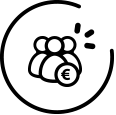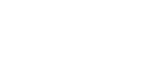Thématique de recherche
Des besoins humanitaires inédits et des crises de nature différente
Ces dix dernières années, les crises humanitaires ont connu une évolution significative due notamment à l’évolution du contexte géopolitique mondial, la pression démographique, la croissance non contrôlée des zones périurbaines[1], des crises et conflits armés prolongés, des pandémies et crises sanitaires inédites[2], un sous-développement chronique, ou encore des catastrophes naturelles plus fréquentes[3] et destructrices[4], notamment en raison du dérèglement climatique[5]. Le nombre de conflits armés a par ailleurs plus que doublé au cours de la dernière décennie et continue d’augmenter, tout comme le nombre de personnes ayant subi des déplacements forcés.[6] Dans ces contextes, l’application et le respect du DIH posent de nombreux défis du fait de l’évolution des conflits contemporains où les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes et la qualification des conflits se complique[7]. Enfin, le changement climatique multiplie les risques de crise et aggrave la vulnérabilité des personnes qui ont déjà besoin d’une aide humanitaire. En 2021, la moitié des personnes dans le besoin d’une aide humanitaire vivaient dans des pays très vulnérables aux effets du changement climatique, et 39 % vivaient dans des pays confrontés à la fois à des conflits de haute intensité, à des niveaux élevés de fragilité socio-économique et à des niveaux élevés de vulnérabilité aux effets du changement climatique[8].
En conséquence, le champ de l’action humanitaire internationale doit faire face aujourd’hui à des besoins d’une ampleur inégalée. Ceux-ci sont désormais chiffrés à plus de 50 milliards de USD, et un total de 339 millions de personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire[9]. Selon ALNAP, entre 2018 et 2021, ce chiffre a augmenté de 87 %, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, qui a fait basculer environ 97 millions de personnes dans l’extrême pauvreté en 2021[10]. Malgré un niveau de ressources financières et humaines historiquement haut[11], le secteur humanitaire ne parvient pas à couvrir l’ensemble de ces besoins, et l’écart entre les demandes de fonds et les financements disponibles ne cesse de s’accroitre[12]. Au-delà de ces problématiques financières, on constate également que la capacité des populations à accéder à l’aide humanitaire dans les situations de conflit armé se détériore, les gouvernements et les groupes armés non étatiques refusant de plus en plus souvent l’accès, et les barrières bureaucratiques se multiplient[13].
Un secteur transformé et remis en question
Au cours de la même période, le secteur humanitaire a connu de profonds bouleversements et questionnements. En 2016, le Sommet humanitaire mondial d’Istanbul et le « Grand Bargain » qui en résulta ont appelé à des réponses « aussi locales que possible, aussi internationales que nécessaire ». L’importance d’une réponse locale était d’ailleurs déjà soulignée de longue date par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment dans son Code de conduite de la réponse aux catastrophes[14]. Le « système humanitaire » international s’est alors engagé à investir davantage dans la capacité des organisations locales à travailler en complément de leurs homologues internationales. Par ailleurs, de nombreuses organisations humanitaires ont dû affronter des controverses internes, ou bien des scandales publics, liés à des accusations de racisme, de violences sexuelles, voire de pratiques néocoloniales posant la question des rapports de pouvoir, notamment dans la continuité du phénomène #MeToo en 2018 et du mouvement Black Lives Matter au courant de l’été 2020[15]. Ainsi, parvenir à une réponse plus « locale » et décentralisée aux besoins humanitaires est apparu dans l’agenda politique comme une réponse possible aux problèmes auxquels se heurte l’humanitaire international, et à la nécessité de le réformer sous peine de réduire les acteurs locaux à des sous-contractants plutôt que des partenaires[16].
Ce mouvement de « localisation de l’aide » est généralement défini comme un processus inclusif des différentes parties prenantes du système humanitaire (États, bailleurs de fonds, organismes des Nations Unies, ONG et organisations locales) qui vise à ramener les acteurs locaux (autorités locales et société civile) au centre du système humanitaire. En plus de permettre une réponse humanitaire plus efficace et ancrée sur l’émancipation des pouvoirs locaux, l’objectif à long terme de la localisation est de renforcer la résilience des communautés touchées par la crise en établissant des liens avec les activités de développement[17].
Depuis 2016, le Grand Bargain a été repensé et a évolué pour devenir le Grand Bargain 2.0[18]. Alors qu’il entrait dans sa cinquième année en 2021, ses signataires ont reformulé l’objectif global du processus pour atteindre de meilleurs résultats. Celui-ci a notamment débouché sur la création de Groupes de références nationaux, pilotés par des acteurs locaux et nationaux. Le but est de supprimer les obstacles à un financement de qualité, et d’apporter un soutien accru au rôle moteur des intervenants locaux, à leurs réalisations et à leurs capacités, ainsi qu’à la participation des communautés touchées aux actions menées pour répondre aux besoins humanitaires[19].
Toutefois, force est de constater que cet engagement peine à se réaliser dans les faits, malgré de nombreuses promesses, dont celle qui engageait les donateurs et organisations d’aide à fournir 25% du financement humanitaire mondial aux intervenants locaux et nationaux d’ici 2020[20]. Alors que la pandémie de covid-19 aurait pu renverser la tendance[21], le secteur humanitaire reste largement concentré. Au niveau financier, en 2021, un petit nombre de gouvernements donateurs a fourni la majeure partie de l’aide humanitaire internationale[22]. La plupart des financements de ces bailleurs de fonds (54 % en 2016) sont allés à des agences multilatérales, et la plus grande partie de cet argent a ensuite été transférée sous forme de subventions à des organisations non gouvernementales (ONG), avec une concentration sur les grandes ONG internationales[23]. À l’autre extrémité de l’échelle, les ONG nationales et locales ont reçu beaucoup moins de fonds directement. Après une augmentation en 2020, le financement direct a diminué de près de deux tiers, pour atteindre le volume (302 millions de USD) et la proportion (1,2 %) de l’aide humanitaire internationale totale la plus basse des cinq dernières années[24].
Un bouleversement accru par une baisse inédite et soudaine des financements internationaux
En janvier 2025, le décret suspendant l’aide étrangère américaine pour 90 jours combiné à l’annonce de baisse de l’aide publique au développement par plusieurs grands donateurs européens[25] a mis le secteur humanitaire dans un état de choc[26]. Ces annonces ont des effets immédiats et multiples sur de nombreux programmes humanitaires en cours et à venir[27] ainsi que sur les organisations elles-mêmes, qu’elles soient locales ou internationales ((interruption de services, licenciements, risques existentiels)[28]. Elles suscitent une forte réaction des ONG et de la communauté internationale[29] qui alertent sur les risques pour les populations vulnérables, en particulier les femmes et les enfants.[30]
Objectifs de l’appel
Ce contexte inédit montre que la période de transition humanitaire, définit comme un changement de paradigme entre le système humanitaire traditionnel construit au 20e s. et la mise en place d’un nouveau paradigme[31], s’accélère et que l’année 2025 marquera certainement un tournant pour l’aide internationale, ne serait-ce que par l’ampleur inégalée de la baisse des financements au 21e siècle.
Fidèle à la thématique structurante de ce programme dédiée à l’analyse des transformations de l’action humanitaire, l’édition 2025 de « Transition humanitaire » invite à documenter des phénomènes sociaux, des dynamiques institutionnelles, des pratiques et innovations opérationnelles, à la croisée des recommandations du Sommet humanitaire mondial et d’un contexte particulièrement alarmant. Il privilégie le regard sur les acteurs humanitaires locales, leurs relations avec le système humanitaire international et les populations accompagnées.
Dans une démarche qualitative ou mixte, les propositions peuvent, par exemple, traiter de mécanismes de résilience, d’initiatives méconnues, d’angles morts ou de nouvelles dynamiques, qui peuvent passer inaperçus dans une vision générale de l’aide mais dont l’étude est essentielle pour mieux comprendre les enjeux du rôle de ces acteurs locaux, nationaux et régionaux et pour repenser plus globalement un système humanitaire sous tension.
Enfin, comme dans de nombreux secteurs qui traversent des périodes de mutations extrêmes, l’approche éthique peut devenir un guide pour l’action, ainsi qu’un objet d’étude pour les chercheurs. C’est pourquoi un éclairage sur la dimension éthique et les modalités de son application sur le terrain est vivement souhaité. La question des savoirs et connaissances peut également être abordée.
[1] MATTEUDI Emmanuel, « L’humanitaire au cœur des enjeux de la ville de demain », In « La bombe urbaine. Quel impact pour les humanitaires ? », Alternatives humanitaires, N° 10, Mars 2019.
[2] TROIT Virginie, « Entre local et global, les organisations humanitaires face aux crises sanitaires mondiales », L’Économie politique, N°87, pages 80 à 90, 2020/3.
[3] Nous assistons depuis plusieurs décennies à une augmentation importante du nombre de catastrophes. En effet, le nombre annuel moyen de catastrophes dites « naturelles » mesuré entre 1997 et 2017 est deux fois plus important qu’entre 1978 et 1997, selon le Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, « Economic Losses, Poverty & Disasters, 1998-2017 », 2018.
[4] FICR, « Rapport 2020 sur les catastrophes dans le monde », 2021. https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-10/2020_WorldDisasters_Full_FR.pdf
[5] BUFFET Christophe, « Les humanitaires au défi du changement climatique », « Changement climatique. Comprendre, anticiper, s’adapter », Alternatives humanitaires, N° 11, Juillet 2019.
[6] Selon ALNAP, il atteint 89,3 millions de personnes en 2021. Voy. ALNAP, « The State of the Humanitarian System », ALNAP study, 358 p., 2022.
[7] JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, « La guerre, le droit et la justice », in L. Gautier (dir.), Mondes en guerre. Tome IV. Guerre sans frontières. 1945-2020, Passés/Composés, p. 453-515, 2021.
[8] Development initiatives, The Global Humanitarian Assistance Report 2022, 129 p, 2022. https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2022/
[9] OCHA, Global Humanitarian Overview 2023, 2023
[10] OBRECHT Alice, SWITHERN Sophia et DOHERTY Jennifer, « The State of the Humanitarian System », ALNAP, 358 p, 2022. https://sohs.alnap.org/
[11] Le nombre de personnes employées par les organisations humanitaires dans leurs opérations continue d’augmenter fortement pour atteindre 630 000 personnes en 2021, soit une augmentation de 11 % par rapport au précédent rapport, en raison du nombre croissant de travailleurs humanitaires nationaux, selon le rapport de l’ALNAP, « The State of the Humanitarian System », 2022. »https://sohs.alnap.org/help-library/2022-the-state-of-the-humanitarian-system-sohs-%E2%80%93-full-report-0
[12] Voir l’article récent de Jessica Alexander sur le volume des besoins, trop important pour l’aide humanitaire. ALEXANDER Jessica (2023), « Earthquake funding gap exposes larger fault lines for emergency aid sector, the New Humanitarian », 21 March 2023 https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2023/03/21/turkiye-syria-earthquake-funding-gap-emergency-aid-sector
[13] Le Mali a par exemple récemment interdit les activités sur financements français, puis expulsé une ONG internationale, Voy. https://www.rfi.fr/fr/afrique/20221217-l-ong-suisse-appel-de-gen%C3%A8ve-est-interdite-au-mali ; En Afghanistan, le régime Taliban a adopté plusieurs mesures visant à interdire l’emploi des femmes par les organisations humanitaires.
[14] FICR, « Code de conduite pour le Mouvement et des ONG lors de la réponse aux catastrophes », Engagement 6 : « Nous nous efforcerons de fonder la réponse aux catastrophes sur les capacités locales », 1994.
[15] AUDET François, « La localisation de l’aide humanitaire : un chantier de recherche en pleine émergence », Revue canadienne d’études du développement, 43(4), 2022.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02255189.2022.2140128
[16] À titre d’exemple, certains acteurs comme le réseau NEAR (Network for Empowered Aid Response, https://www.near.ngo/), un mouvement d’organisations de la société civile locales et nationales du Sud, œuvrent à autonomiser les ONG locales et nationales des pays du Sud pour qu’elles jouent un rôle positif et actif dans le système d’aide mondial.
[17] La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a participé activement au Groupe de travail n° 2 mis en place dans le cadre du « Grand bargain », dont l’objectif est de trouver des moyens d’« apporter davantage de soutien aux intervenants locaux et nationaux et de renforcer les mécanismes de financement dont ils disposent ». https://gblocalisation.ifrc.org/grand-bargain-localisation-workstream/
[18] IASC (interagencystandingcommittee.org), « The Grand Bargain 2.0 Structure » https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-20-structure
[19] Guidance Note on National Reference Groups [ARA, EN, ES, FR, Indonesian] | IASC (interagencystandingcommittee.org) https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/guidance-note-national-reference-groups
[20] COMMISSION EUROPEENNE. EU/DG ECHO, « Guidance note – Promoting Equitable Partnerships with Local Responders in Humanitarian Settings », 2023. https://interagencystandingcommittee.org/eudg-echo-guidance-note-promoting-equitable-partnerships-local-responders-humanitarian-settings.
[21] TROIT Virginie, « Entre local et global, les organisations humanitaires face aux crises sanitaires mondiales », L’Économie politique, N°87, pages 80 à 90, 2020/3.
[22] Les 20 principaux donateurs en 2021 ont fourni la quasi-totalité de l’aide humanitaire internationale publique, représentant 97 % de toutes les allocations, et les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont été les trois principaux donateurs chaque année au cours de la dernière décennie, ces trois donateurs représentant à eux seuls 59 % de l’aide humanitaire internationale publique.
Development initiatives, The Global Humanitarian Assistance Report 2022, 129 p, 2022.
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] « Aide au développement : le grand repli européen », Le Monde, 14 novembre 2024
[26] https://www.forbes.com/sites/globalcitizen/2025/02/25/foreign-aid-is-shrinking-what-happens-next/ + voir coordination Sud et ICVA
[27] Emma Farge, Maggie Fick, Poppy Mcpherson, Humeyra Pamuk, Jennifer Rigby, « Trump’s aid freeze sparks mayhem around the world », Reuters, February 8, 2025.
[28] ICVA « The Impacts of the US Funding Suspension », 18 February 2025 https://www.fondation-croix-rouge.fr/recherches-soutenues/solidarites-citoyennes-dans-les-campements-dexiles/
[29] MSF « Le gel de l’aide étrangère des États-Unis entraînera une catastrophe humanitaire », 12 février 2025 https://www.msf.fr/actualites/le-gel-de-l-aide-etrangere-des-etats-unis-entrainera-une-catastrophe-humanitaire
[30] ICVA « The Impacts of the US Funding Suspension ». Op. Cit.
[31] MATTEI Jean-François, TROIT Virginie, « La transition humanitaire », Med Sci (Paris), Volume 32, Number 2, Février 2016. https://doi.org/10.1051/medsci/20163202016
Zones géographiques de recherche
Ces thèmes pourront être abordés empiriquement dans quatre territoires prioritaires : la France hexagonale, les territoires ultramarins et territoires étrangers de proximité dans les 3 Océans, l’Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient. Ces territoires prioritaires ne sont toutefois pas exclusifs. Le soutien de la Fondation peut s’étendre à toute zone géographique, si les projets de recherche réunissent, entre autres, les conditions de sécurité et de faisabilité exigées.
L’accès au terrain sera conditionné par une évaluation précise des risques remise lors de la candidature et mise à jour avant le départ en prenant soin de vérifier au préalable les recommandations du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français.
Crédit photo : Georges Djohy (Bénin)
Bourse de recherche (individuelle)
Nombre de bourses : 1
Montant : 19 800 € (chacune)
Chaque lauréat bénéficiera en outre de :
- la possibilité de solliciter une participation aux frais d’assurance liés au terrain (pour un montant maximum de 500 euros).
- suivi scientifique et tutorat personnalisés
- accompagnement dans la valorisation des résultats de la recherche (traduction en anglais, publications sur ce site, soutien pour publier dans des revues d’excellence et notamment dans la revue Alternatives humanitaires, participation aux Rencontres de la Fondation)
- abonnement d’un an à la revue Alternatives humanitaire
Dates clés :
- 17 mars 2025 : lancement de l’appel
- 27 avril 2025 : clôture des candidatures à minuit (heure de Paris)
- 21 juin 2025 : annonce des résultats
- 1er septembre 2025 : début de la recherche
- 1er septembre – 1er décembre 2026 : rendu des livrables finaux
Mots-clés :
- Autonomie
- Gouvernance
- Coopération
- Localisation
- Humanitaire
Financé par :