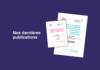Lors de cette 9e édition de nos Pauses-Culture-Recherche au Campus Croix-Rouge, Virginie Troit, directrice générale de la Fondation et titulaire d’une bourse de la commission franco-américaine Fulbright NGO Leaders, est revenue sur son séjour de 4 mois (de février à mai 2025) à l’Université Columbia de New York autour du projet «Transformer la relation entre la recherche et les sociétés civiles pour reconfigurer le(s) système(s) humanitaire(s).»

Lors de son intervention, Virginie a rappelé les grands bouleversements récents dans les secteurs humanitaire et scientifique, et les enjeux croissants liés à leur interaction. Elle a partagé ses réflexions autour de son questionnement : Pourquoi s’intéresser à la relation entre universités et organisations humanitaires ?
Virginie Troit a fait l’historicité des relations entre le monde universitaire et les acteurs humanitaires modernes. Elle a évoqué la proximité du CICR avec le secteur académique, notamment avec les juristes, l’émergence de la Revue du CICR puis l’importance de l’intrication de l’expertise en santé/médecine lors de la création de la Ligue des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1919. Sujet sur lequel portait la Pause Culture Recherche n°7 avec Romain Fathi.
Elle nous a expliqué comment ce lien s’est renforcé avec la montée de la professionnalisation et des exigences en redevabilité dans les années 1990. On a en effet besoin de formations professionnelles et de données basées sur les preuves, des activités que les universités accompagnent. Puis à partir des années 2000 de nouvelles entités dédiées aux savoirs humanitaires se forment au sein d’ONG, en tant que Think Tanks ou firmes de consultance privées, ou comme initiatives universitaires dédiées, un mouvement auquel la Fondation appartient mais avec un modèle assez unique.
Son étude aux États-Unis visait à mieux comprendre les dynamiques entre ces deux mondes. Le pays est un acteur majeur dans le domaine humanitaire, abritant de nombreux sièges d’ONGI comme CARE, IRC, Mercy Corps, World Vision, des représentations nationales de réseaux transnationaux (MSF, Save the Children, Oxfam, Concern etc.) et de nombreuses universités parmi les plus prestigieuses. Elle a ainsi conduit 54 entretiens avec des représentants d’universités, d’ONG américaines et internationales, d’organisations internationales et de bailleurs.
Elle a mis en lumière un paysage universitaire fragmenté, sans modèle unique, mais qui a innové, souvent structuré autour des épicentres humanitaires comme New York et Washington. Suite à une courte cartographie et présentation d’initiatives développées dans des université telles que Columbia, Harvard, Tufts, John Hopkins, Yale, GW ou Fordham, elle a souligné la richesse des approches interdisciplinaires, le rôle central des pracademics (profils de chercheurs devenus praticiens ou vice-versa) et les ponts entre enseignements et activités de recherche jusque sur les “terrains”.
Enfin, cette Pause Culture Recherche a offert un éclairage précieux sur les liens entre recherche et action humanitaire, dans un contexte international en recomposition, posant la question du modèle économique. Elle a également ouvert plusieurs pistes de réflexion essentielles pour la France, où les centres de ressources sont nombreux mais encore peu coordonnés autours de vrais hubs de recherche.
Il s’agit désormais d’interroger l’état des lieux et l’évolution de ces espaces de coopération entre universités, société civile, acteurs publics et privés : Quels types de coopérations sont actuellement en œuvre ? Sont-elles du niveau des politiques ou des pratiques ? Et quelles finalités servent-elles entre l’innovation, le plaidoyer, la résolution de problèmes opérationnels ou institutionnels ? Y a-t-il une place pour des alliances innovantes multi-acteurs à l’intersection de deux secteurs largement sous tensions ? Quelles opportunités présentent les villes comme Paris, à la fois centre de décisions où convergent les étudiants, les chercheurs, les décideurs nationaux et internationaux et les humanitaires ?
Autant de questions à poursuivre collectivement pour construire des passerelles durables entre recherche et action humanitaire alors que la nouvelle donne des financements fait porter un risque immédiat pour des espaces parfois perçus comme non prioritaires et pourtant de plus en plus indispensables pour l’action, la décision et la lutte contre la désinformation.

Retrouvez ci dessous toutes les précédentes éditions de nos Pauses-Culture-Recherche :