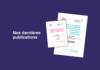Retour sur la 13e édition du webinaire de la Fondation l’Instant Recherche, qui a réuni en ligne mercredi 8 octobre deux chercheurs soutenus par la Fondation, Emmanuelle Durand et Jérémie Grojnowski, et l’anthropologue Alexandra Galitzine-Loumpet pour discuter des « Objets de l’exil ».
Le contexte
Les migrations et déplacements de populations font partie des thèmes de recherche prioritaires de la Fondation Croix-Rouge française. Ces phénomènes représentent un défi humanitaire majeur au sein et entre les États, mobilisant de nombreuses organisations de solidarité et des initiatives plus spontanées. Les parcours d’exil se sont complexifiés ces dernières années, du fait de politiques migratoires plus restrictives, créant de nouveaux espaces de vulnérabilité. Les sciences sociales se sont largement engagées pour mieux comprendre et documenter ces expériences et les réponses publiques ou privées qui y sont apportées. Plus largement, la Fondation soutient aussi la recherche sur les expériences de l’exil, des situations de précarité économique, administrative, sociale et émotionnelle, qui ne font que s’aggraver dans le contexte de non-accueil, quand l’attente, l’incertitude du lendemain et l’urgence de se nourrir, se loger et se mettre en sécurité se prolongent.
L’exil ne se limite pas à un simple déplacement géographique : il implique un transport de significations, d’identités, de mémoires et de pratiques inscrites dans des objets matériels. Ces objets, souvent discrets ou ordinaires, deviennent des témoins essentiels de l’expérience migratoire. Sociologues, anthropologues et archéologues s’accordent à voir dans ces artefacts des marqueurs concrets des liens qui unissent les individus à leur histoire, leur culture et leur environnement d’accueil. Dans cette perspective, l’objet de l’exil est à la fois trace du passé, outil de reconstruction identitaire et support d’une mémoire vive, souvent tiraillée entre ici et ailleurs.
La discussion
Cette treizième édition de « l’Instant recherche » de la Fondation Croix-Rouge française a réuni deux chercheuses et un chercheur qui proposent de partir des objets de la migration pour appréhender la condition des personnes en exil.
Alexandra Galitzine-Loumpet a ouvert la discussion en proposant la définition de l’exil d’Edward Saïd : l’exil est une vie simultanée, une discontinuité dans l’être qui se retrouve dans les objets, supports matériels d’une vie présente et passée. Toujours situés entre l’intime et le politique, ils ne se réduisent pas aux tentes, sacs et gilets de sauvetage… mais représentent un ensemble imprédictible et hétéroclite. Elle donne l’exemple des manches de rasoir bics, utilisées comme outils dans les trains entre la France et l’Italie pour se cacher dans les compartiments fermés aux voyageurs. Les objets de l’exil sont au point d’articulation entre la matérialité et la subjectivité : ce qu’on appelle en anthropologie la chose.
Jérémie Grojnowski poursuit en évoquant le Repair Lab, un dispositif de la Croix-Rouge française qui propose la remise en état d’objets de première nécessité pour des personnes exilées. En plus d’être confrontés à la précarité, celles-ci font face à une urgence matérielle. Le peu d’objets qu’elles possèdent encore sont souvent dégradés après un long parcours migratoire. Par exemple, les mineurs non accompagnés campant dans des squares peinent à conserver leurs chaussures plus de deux mois. Au-delà du soutien technique et social, la réparation stabilise l’environnement matériel des bénéficiaires, car réutiliser un objet affectionné ou indispensable est source d’apaisement. Certains usagers projettent une part de leur vécu sur ces objets familiers, qu’ils perçoivent comme dotés d’une histoire propre. Cet « attachement aux choses » est perceptible lorsqu’ils ont conservé une valise, un tapis de prière ou une cafetière au terme d’un long trajet, ou lorsqu’ils possèdent davantage de biens devenus, avec le temps, des « objets biographiques », à l’image d’un sac à dos déchiré ou d’un diffuseur d’encens. La réparation prolonge la vie intime des choses et enrichit la valeur qu’elles portent pour leurs propriétaires. Elle participe à leur « singularisation », c’est-à-dire à leur autonomisation vis-à-vis de la valeur marchande, et souligne l’agentivité des personnes en exil.
Les représentations et usages du vêtement étudiés par Emmanuelle Durand s’inscrivent également au croisement de l’intime et du politique. Les vêtements choisis et portés par les personnes en exil sont empreints d’attentes sociales et symboliques liées au goût, aux désirs et aux pratiques culturelles. Emmanuelle Durand illustre cela avec l’exemple du choix des vêtements dans les vestiboutiques de la Croix-Rouge française, où elle a mené une partie de son enquête. Ce choix intègre des variables liées à l’exil comme la durabilité et la préférence pour des couleurs non salissantes, mais s’inscrit aussi dans une culture globalisée qui valorise des marques très connues. La chercheuse a également souligné la nécessité de prendre en compte les différences générationnelles et de genre qui peuvent impacter les perceptions du vêtement et générer de l’incompréhension entre les bénévoles, souvent des femmes retraitées, et les jeunes hommes migrants venus chercher de quoi se vêtir.
Visionnez le replay
Les intervenants

Emmanuelle Durand est anthropologue et chercheuse post-doctorante (IRIS-EHESS). Ses travaux portent sur les matérialités politiques, les filières marchandes et les infrastructures logistiques, qu’elle explore à partir des matériaux de rebut dans une démarche à la fois ethnographique, filmique et sonore. Elle s’intéresse particulièrement aux pratiques économiques globalisées, qu’elle documente en mobilisant une pluralité d’outils d’enquête et de supports de diffusion. Sa thèse de doctorat intitulée « Des vies en fripes » est une étude des circulations du vêtement usagé au Liban et retrace les trajectoires sociales du vêtement en articulant les notions de circulation, de valeur et de souillure. Ses recherches s’inscrivent dans une dynamique collective, pluridisciplinaire et internationale.
→ Consultez la fiche recherche d’Emmanuelle Durand
Parmi ses publications :

Jérémie Grojnowski, formé à la philosophie, la sémiologie et l’anthropologie visuelle, est maître de conférences en études cinématographiques à l’Université Paris Nanterre. Ses recherches se situent au croisement de l’anthropologie visuelle, de l’anthropologie du faire et des techniques, ainsi que de la sociologie de l’innovation. À travers la réalisation de films ethnographiques, il s’intéresse à des alternatives technologiques allant des contre-cultures numériques aux pratiques low-tech. Sa thèse, consacrée aux « paysans auto-constructeurs », a donné lieu au film « Jours d’après », diffusé dans plusieurs festivals nationaux et internationaux. La recherche intitulée « Autonomie technique et émancipation psychosociale », qu’il a menée dans le cadre du programme Bénévo’Lab de la Fondation, s’inscrit dans la continuité de ses précédents travaux, en questionnant la portée émancipatrice de l’activité de réparation.
→ Consultez la fiche recherche de Jérémie Grojnowski
Parmi ses publications :
2021, Une expérimentation low-tech de l’autonomie énergétique et alimentaire, revue EcoRev’ N°51
2020, Jours d’après, documentaire de 72 minutes

Alexandra Galitzine-Loumpet est anthropologue, docteure habilitée à diriger des recherches (HDR), membre du Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA). Ses travaux portent sur les migrations contemporaines, les expériences de l’exil, les subjectivités aux frontières, ainsi que sur les langues, les violences et les résistances dans les espaces migratoires. Elle a co-dirigé les ouvrages L’objet de la migration, le sujet dans l’exil (Presses Universitaires de Nanterre, 2020) et Lingua (non) grata. Langues, violences et résistances dans les espaces de la migration (avec Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, Presses de l’Inalco, 2022). Elle a également assuré la codirection scientifique de la base de données Migralect.com, consacrée aux langues en migration et coordonne le programme Co-front – Co-construction des savoirs aux frontières (Institut Convergences Migrations) de même que le programme Non-lieux de l’exil, une plateforme de réflexion et de recherche sur les expériences migratoires et les formes d’errance contemporaine.
Parmi ses publications :
2020, L’objet de la migration, le sujet dans l’exil » Presses Universitaires de Nanterre