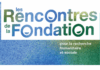Chaque semestre, la Fondation organise un webinaire, « L’Instant Recherche ». Nous y invitons des spécialistes engagés pour un échange libre et exigeant, où la diversité des savoirs, des pratiques et des principes ouvre de nouveaux horizons à la réflexion menée par la Fondation et à l’émergence de modèles d’action innovants.
La prochaine édition de l’Instant Recherche a lieu le mercredi 8 octobre de 17h à 18h30 (heure de France, UTC + 2h), en ligne sur Zoom, sur la thématique des objets de l’exil. Le lien de connexion sera envoyé aux personnes inscrites.
Programme
- 17h00 : Introduction de Vincent Leger, chargé de recherche de la Fondation
- 17h10 : Table ronde avec les 3 chercheurs, sous la modération de Vincent Leger
- 18h10 : Questions-réponses avec le public
- 18h30 : Fin
Thématique
L’exil ne se limite pas à un simple déplacement géographique : il implique un transport de significations, d’identités, de mémoires et de pratiques inscrites dans des objets matériels. Ces objets, souvent discrets ou ordinaires, deviennent des témoins essentiels de l’expérience migratoire. Sociologues, anthropologues et archéologues s’accordent à voir dans ces artefacts des marqueurs concrets des liens qui unissent les individus à leur histoire, leur culture et leur environnement d’accueil. Dans cette perspective, l’objet de l’exil est à la fois trace du passé, outil de reconstruction identitaire et support d’une mémoire vive, souvent tiraillée entre ici et ailleurs.
L’étude des objets dans le contexte de l’exil permet de penser la migration non plus seulement comme un déplacement de personnes, mais aussi comme un déplacement de significations, d’affects et de matérialités. L’objet devient un support de mémoire, une trace d’un passé parfois enfoui, un outil de projection vers l’avenir, mais aussi un espace de conflit, de négociation et de résistance. L’objet de l’exil est donc, pour les sciences sociales, une porte d’entrée vers une compréhension plus fine, plus incarnée, et plus politique des réalités migratoires contemporaines.
La treizième édition de « l’Instant recherche » de la Fondation Croix-Rouge réunira deux chercheuses et un chercheur qui proposent de partir des objets de la migration pour appréhender la condition des sujets en exil. Avec Emmanuelle Durand, nous verrons comment représentations et pratiques vestimentaires révèlent l’histoire, l’identité et le parcours des migrants, et comment textiles et vêtements agissent comme des marqueurs symboliques puissants, entre mémoire, engagement et réinvention. A travers l’expérience du Repair Lab Humanitaire Itinérant, mis en place par la Croix-Rouge française pour aider des personnes exilées en transit à réparer elles-mêmes leurs effets personnels, Jérémie Grojnowski expliquera comment l’accompagnement vers plus d’autonomie technique est susceptible de constituer un levier d’émancipation psychosociale pour les exilés. Enfin, avec Alexandra Galitzine-Loumpet nous interrogerons l’existence d’une culture matérielle de la migration et montrerons en quoi l’objet fait trace et comment il fait place au sujet.
Les intervenants

Emmanuelle DURAND est anthropologue et chercheuse post-doctorante (IRIS-EHESS). Ses travaux portent sur les matérialités politiques, les filières marchandes et les infrastructures logistiques, qu’elle explore à partir des matériaux de rebut dans une démarche à la fois ethnographique, filmique et sonore. Elle s’intéresse particulièrement aux pratiques économiques globalisées (production, circulation, consommation), qu’elle documente en mobilisant une pluralité d’outils d’enquête et de supports de diffusion : films, sons, cartographies textiles, photographies. À travers cette approche, elle interroge les formes de dialogue possibles entre démarche anthropologique et geste créatif. Sa thèse de doctorat intitulée « Des vies en fripes » est une étude des circulations du vêtement usagé au Liban et retrace les trajectoires sociales du vêtement en articulant les notions de circulation, de valeur et de souillure. Emmanuelle Durand enseigne également à l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles. Ses recherches s’inscrivent dans une dynamique collective, pluridisciplinaire et internationale.
Parmi ses publications :
- 2025, « Du don vestimentaire au gisement de déchets: politiques et pratiques de rejet textile », Journal des anthropologues (à paraître été 2025)
- 2024, L’envers des fripes. Les vêtements dans les plis de la mondialisation, Paris, Premier Parallèle, Techniques & Culture

Alexandra GALITZINE-LOUMPET est anthropologue, docteure habilitée à diriger des recherches (HDR), membre du Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques (CESSMA). Ses travaux portent sur les migrations contemporaines, les expériences de l’exil, les subjectivités aux frontières, ainsi que sur les langues, les violences et les résistances dans les espaces migratoires. Elle a codirigé les ouvrages L’objet de la migration, le sujet dans l’exil (Presses Universitaires de Nanterre, 2020) et Lingua (non) grata. Langues, violences et résistances dans les espaces de la migration (avec Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, Presses de l’Inalco, 2022). Elle a également assuré la codirection scientifique de la base de données Migralect.com, consacrée aux langues en migration et coordonne le programme Co-front – Co-construction des savoirs aux frontières (Institut Convergences Migrations) de même que le programme Non-lieux de l’exil, une plateforme de réflexion et de recherche sur les expériences migratoires et les formes d’errance contemporaine.
Parmi ses publications :

Jérémie GROJNOWSKI, formé à la philosophie, la sémiologie et l’anthropologie visuelle, est maître de conférences en études cinématographiques à l’Université Paris Nanterre. Ses recherches se situent au croisement de l’anthropologie visuelle, de l’anthropologie du faire et des techniques, ainsi que de la sociologie de l’innovation. À travers la réalisation de films ethnographiques, il s’intéresse à des alternatives technologiques allant des contre-cultures numériques aux pratiques low-tech. Sa thèse, consacrée aux « paysans auto-constructeurs », a donné lieu au film « Jours d’après », diffusé dans plusieurs festivals nationaux et internationaux. La recherche intitulée « Autonomie technique et émancipation psychosociale », qu’il a menée dans le cadre du programme Bénévo’Lab de la Fondation, s’inscrit dans la continuité de ses précédents travaux, en questionnant la portée émancipatrice de l’activité de réparation.
Parmi ses publications :
Revoir nos éditions précédentes :
- 1ère édition « Le regard des sciences sociales sur les épidémies en Afrique » (novembre 2020) ;
- 2ème édition « Le regard des sciences sociales sur une action humanitaire locale » (décembre 2020) ;
- 3ème édition « Le regard des sciences sociales sur les migrations » (janvier 2021) ;
- 4ème édition « Le regard des sciences sociales sur les catastrophes » (mai 2021) ;
- 5ème édition « Océan Indien : terre de défis et innovations pour les acteurs humanitaires » (octobre 2021).
- 6ème édition « Action humanitaire et accès aux soins : quels nouveaux modèles pour une effectivité du droit à la santé ? » (mai 2022)
- 7ème édition « Exils et accueils : l’expérience migratoire au prisme des sciences sociales » (décembre 2022)
- 8ème édition « De l’urgence humanitaire à la résilience » (juin 2023)
- 9ème édition « Genre et action humanitaire : la place des femmes dans l’humanitaire d’hier à aujourd’hui » (novembre 2023)
- 10ème édition « Gestes qui sauvent : réalités, défis et innovations » (mai 2024)
- 11ème édition « Urgence et enjeux durables : l’aide alimentaire à réinventer » (octobre 2024)
- 12ème édition « Perte d’autonomie : quelles solutions pour les personnes âgées dépendantes ? » (avril 2025)
Crédit photo : © Georgia Trismpioti-IFRC